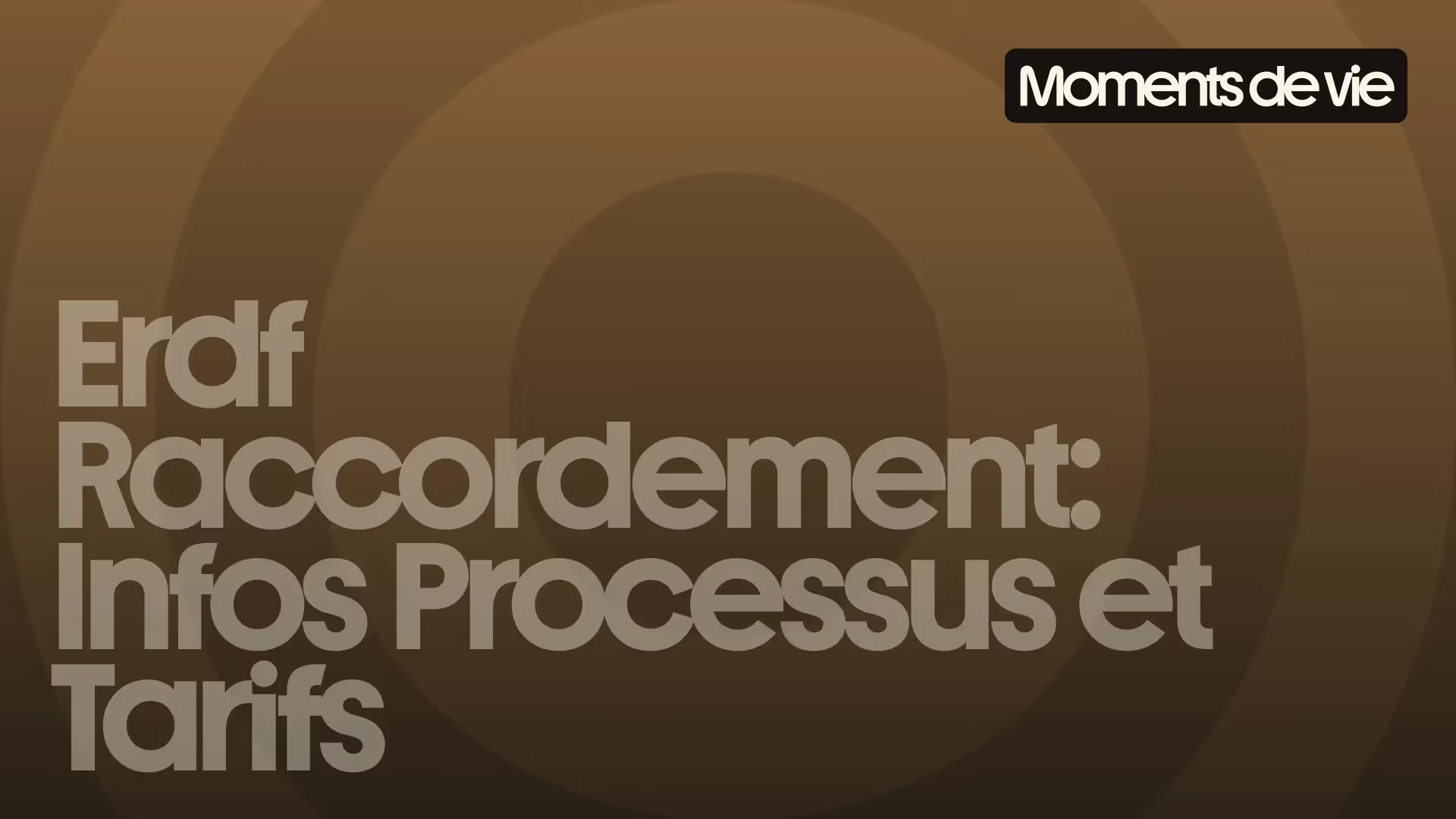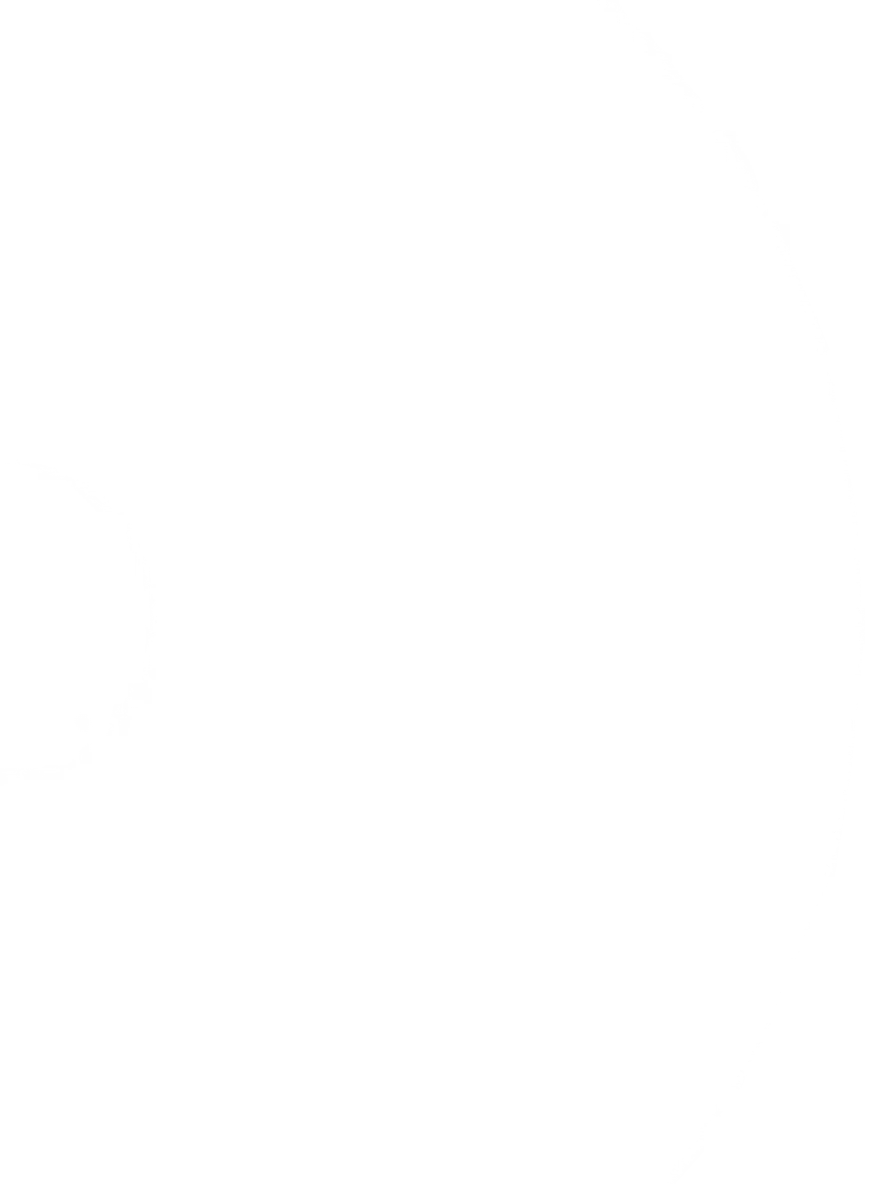L'énergie est au cœur de nos vies quotidiennes et du fonctionnement de nos sociétés. Du simple geste d'allumer une lumière à l'alimentation de nos industries, elle est indispensable. Mais d'où vient cette énergie ? Comment est-elle produite et quels sont ses impacts ? Alors que la transition énergétique est devenue un enjeu mondial majeur, il est essentiel de comprendre les mécanismes qui régissent ce secteur complexe pour devenir un consommateur averti et responsable.
Les différentes sources d'énergie et leurs impacts
On classe généralement les sources d'énergie en deux grandes catégories : les énergies non renouvelables et les énergies renouvelables. Chacune présente des avantages et des inconvénients, notamment en termes d'impact environnemental.
Les énergies non renouvelables, ou énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, sont issues de la décomposition d'organismes vivants sur des millions d'années. Elles représentent encore une part majoritaire de la consommation énergétique mondiale. Leur principal avantage réside dans leur forte densité énergétique, mais leur combustion est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre, contribuant massivement au changement climatique. L'énergie nucléaire, issue de la fission d'atomes d'uranium, est également une source non renouvelable. Si elle a l'avantage de produire de l'électricité sans émettre de CO2, la question de la gestion des déchets radioactifs et le risque d'accidents restent des préoccupations majeures.
Les énergies renouvelables, quant à elles, proviennent de sources naturelles qui se renouvellent rapidement : le soleil (photovoltaïque et thermique), le vent (éolien), l'eau (hydroélectricité), la chaleur de la Terre (géothermie) et la biomasse (bois, déchets végétaux). Leur développement est au centre des stratégies de transition énergétique car leur impact environnemental est considérablement plus faible. Elles n'émettent que très peu de gaz à effet de serre lors de leur phase d'exploitation.
Le mix énergétique français : un modèle décarboné
Le mix énergétique désigne la répartition des différentes sources d'énergies primaires utilisées pour répondre aux besoins d'un pays. En France, ce mix a la particularité d'être l'un des plus décarbonés d'Europe, principalement grâce à son parc nucléaire historique.
En 2023, la production d'électricité en France se répartissait de la manière suivante :
- Nucléaire : environ 64,2 %
- Énergies renouvelables : environ 28,2 % (dont 11,5 % pour l'hydraulique, 9,9 % pour l'éolien, 4,3 % pour le solaire et 2,2 % pour les bioénergies)
- Thermique fossile (gaz, charbon, fioul) : environ 7,6 %
Cette structure permet à la France d'afficher des émissions de CO2 par kilowattheure produit particulièrement faibles par rapport à ses voisins européens. L'intensité carbone de la production électrique française a même atteint un niveau historiquement bas en 2024, à 21,7 gCO2eq par kilowattheure. L'objectif est désormais d'augmenter le volume d'électricité décarbonée pour répondre aux nouveaux usages (véhicules électriques, réindustrialisation) tout en poursuivant le développement des énergies renouvelables.
Comment garantir l'origine "verte" de l'électricité ? Le rôle des Garanties d'Origine (GO)
Lorsqu'un consommateur souscrit une offre d'électricité "verte", comment peut-il être certain de l'origine renouvelable de son énergie ? Physiquement, il est impossible de trier les électrons sur le réseau de distribution. C'est ici qu'intervient le système des Garanties d'Origine (GO).
Une Garantie d'Origine est un certificat électronique qui atteste qu'une quantité d'électricité équivalente à 1 MWh (mégawattheure) a été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable et injectée dans le réseau. En France, c'est l'organisme EEX (anciennement Powernext) qui est chargé de délivrer ces certificats aux producteurs.
Lorsqu'un fournisseur d'électricité commercialise une offre verte, il doit acheter un nombre de GO correspondant à la consommation de ses clients sur une période donnée. Ces GO sont ensuite "annulées" dans un registre national pour prouver qu'elles ont bien été utilisées et ne peuvent être revendues. Ce mécanisme assure une traçabilité comptable et financière, garantissant au client final qu'une part équivalente à sa consommation a bien été produite à partir de sources renouvelables. L'achat de GO par les fournisseurs permet également d'apporter un revenu complémentaire aux producteurs d'énergies renouvelables, soutenant ainsi le développement de ces filières.
Les conséquences de la transition énergétique pour le client final
La transition vers un modèle énergétique plus durable n'est pas sans conséquences pour le consommateur. Elle se traduit par des évolutions sur la facture d'électricité, mais aussi par de nouvelles opportunités.
La composition de la facture d'électricité se divise en trois grandes parties :
- La fourniture d'énergie : C'est le coût de production et d'achat de l'électricité par le fournisseur. C'est la seule partie réellement soumise à la concurrence.
- L'acheminement (TURPE) : Il s'agit des coûts liés au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'au consommateur final. Ces tarifs sont régulés par la CRE (Commission de Régulation de l'Énergie).
- Les taxes et contributions : Elles représentent une part importante de la facture et incluent notamment la TVA et l'accise sur l'électricité (ancienne CSPE).
Le développement des énergies renouvelables, qui nécessitent d'importants investissements, peut avoir un impact sur les coûts de production et d'acheminement, et donc sur la facture finale. Cependant, cette transition est également synonyme d'opportunités pour les consommateurs.
L'État et les collectivités proposent de nombreuses aides pour encourager les particuliers à participer activement à cette transition, notamment à travers la rénovation énergétique des logements. Des dispositifs comme MaPrimeRénov' ou l'éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) permettent de financer des travaux d'isolation, l'installation de systèmes de chauffage plus performants comme une pompe à chaleur, ou encore la pose de panneaux solaires en autoconsommation. Ces investissements permettent non seulement de réduire l'empreinte carbone de son logement, mais aussi de réaliser d'importantes économies d'énergie sur le long terme.